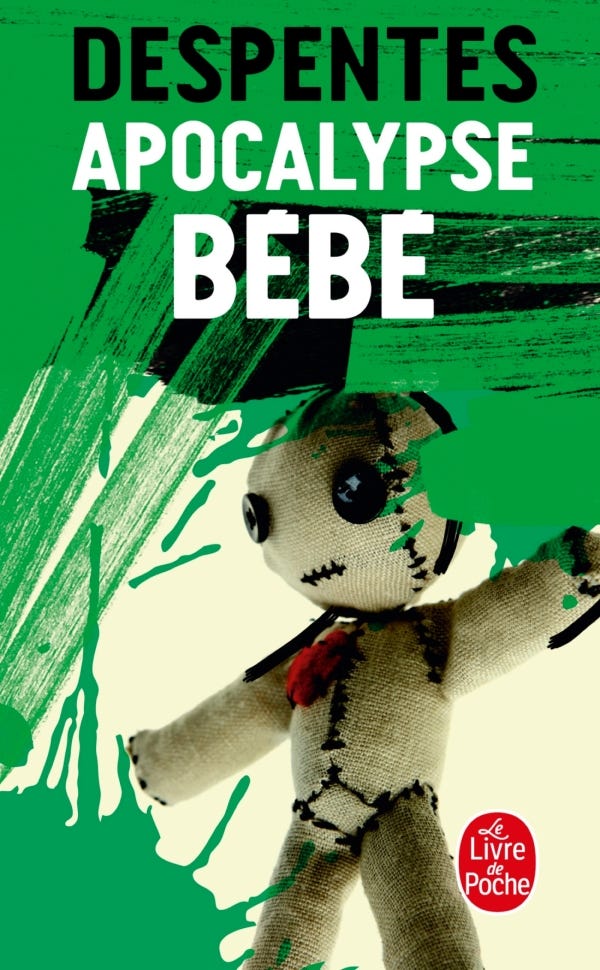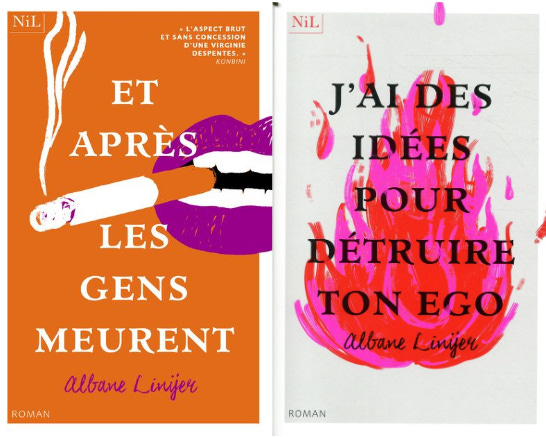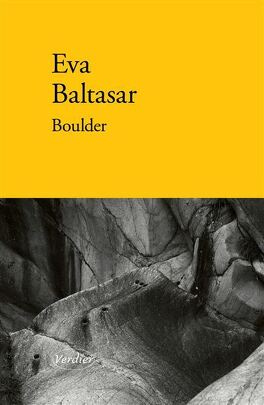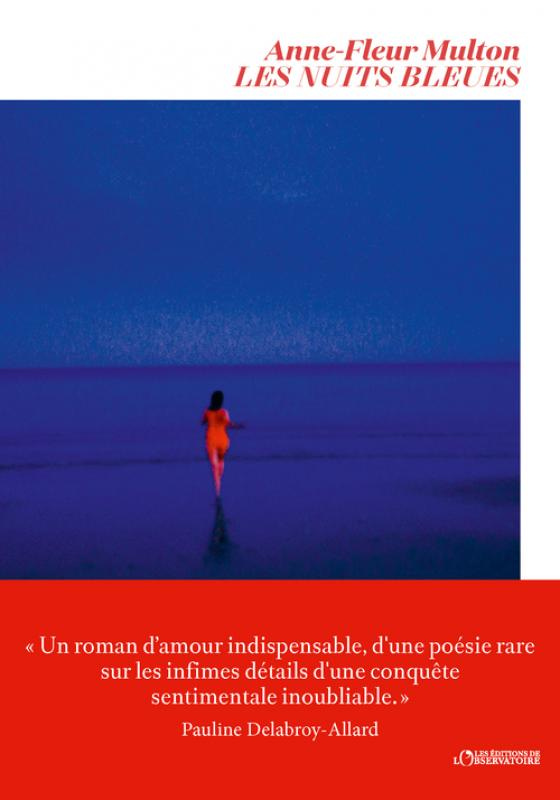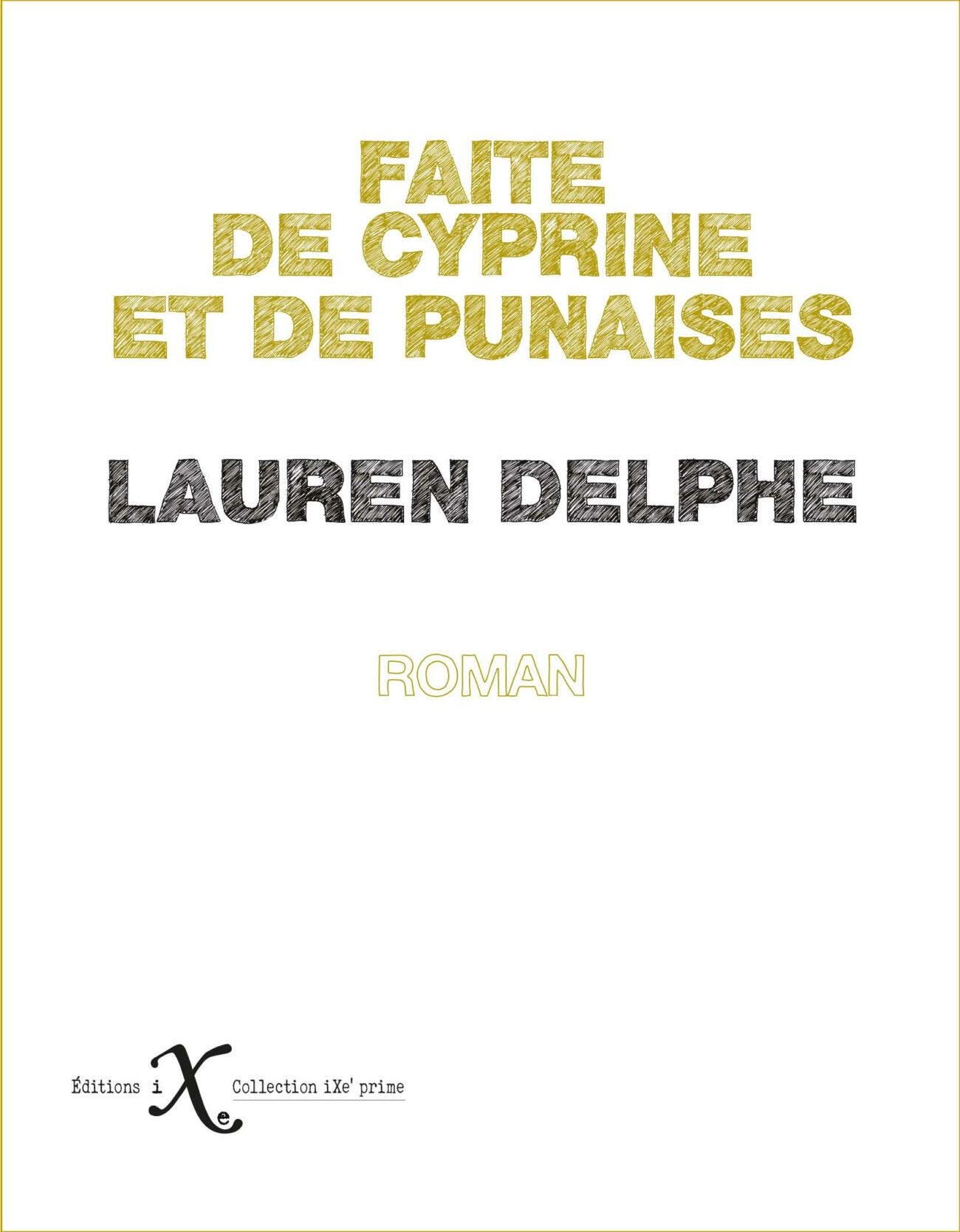#2 "Être lesbienne est une fête"
Bienvenue dans Gouineries chaotiques, la newsletter dédiée aux littératures lesbiennes contemporaines en France.
“Être lesbienne est une fête”. J’ai aimé cette phrase d’Alice Coffin dès ma première lecture du Génie lesbien. Je me la répète, souvent, et je l’ai même mise en conclusion de mon chapitre d’Écrire à l’encre violette. Parce que, trop souvent, on a l’impression que nos représentations - et par extension nos vies - sont au mieux mélancoliques, au pire tragiques, qu’il s’agisse de films, de livres ou de séries. On ne va pas se mentir : il faut creuser un peu pour trouver des productions culturelles (hors romance) où les lesbiennes vivent et/ou finissent complètement heureuses.
Alors voici quelques titres - français ou traduits en français - de littérature générale qui me font rire et sourire à chaque lecture parce que, ne l’oublions pas, la vie est quand même sacrément plus joyeuse et trépidante loin du monde cishétéro :
Virginie Despentes, Apocalypse Bébé (2010) : un road trip improbable de Paris à Barcelone, avec une orgie queer, un éveil tardif au lesbianisme, et la première apparition d’une Hyène absolument insupportable (ou délicieuse, c’est selon)
Albane Linÿer, J’ai des idées pour détruire ton égo (2019) & Et après les gens meurent (2022) : deux romans qui se suivent et qui sont savamment bordéliques. On y suit, entre autres personnages, le parcours de Léonie, qui travaille dans un fast food et comme baby-sitter, tout en ayant une vie amoureuse et sexuelle tout à fait chaotique. Jusqu’au jour où elle se retrouve à avoir la charge d’Eulalie, l’enfant qu’elle garde, ce qui n’était clairement pas dans son plan de vie. On retrouve les mêmes personnages dans le deuxième roman, alors qu’Eulalie a désormais 17 ans et beaucoup de questions
Eva Baltasar, Boulder (2020, trad. Annie Bats 2022) : j’en ai déjà parlé dans la première édition de cette newsletter, une critique mordante et jouissive de la maternité et plus globalement des vies hétéronormées, d’un point de vue lesbien. J’en parle plus longuement sur Instagram et dans le dernier numéro de Jeanne Magazine
Anne-Fleur Multon, Les Nuits bleues (2022) : fait exceptionnel, un roman lesbien presque 100% feel good ! La naissance d’une histoire d’amour à Paris pendant le premier confinement, c’est très doux et ça fait du bien
Éparpillements
“Aussi les corps rebelles/nombreux / sont-ils isolés dans leur rébellion épars” (Michèle Causse, “L'Encontre”)
Choses lues, vues, écoutées en lien avec les littératures et cultures lesbiennes
2023, année Wittig ! A l’occasion des cinquante ans de la parution du Corps lesbien, et des vingt ans de la mort de Monique Wittig, de nombreux événements ont lieu tout au long de l’année. Ils sont tous recensés au fur et à mesure par l’association des Ami.es de Monique Wittig sur leur site.
La pensée et l’oeuvre de Monique Wittig sont complexes, alors j’ai voulu faire une sélection de podcasts, articles mais aussi d’événements à venir permettant d’obtenir quelques clefs de compréhension :
L’épisode 27 du podcast Camille chez Binge Audio, “Sexy Wittig”, avec Clémence Allezard : très accessible, excellente porte d’entrée
“Monique Wittig, écrivain et lesbienne révolutionnaire (1935–2003)”, de Clémence Allezard pour Une vie une oeuvre & “Pourquoi lire Monique Wittig, celle qui affirmait que “les lesbiennes ne sont pas des femmes” ?” dans Sans oser le demander. Deux émissions de France Culture, un peu plus exigeantes mais passionnantes. Dans le premier, Clémence interroge notamment de nombreuses personnes ayant connu et travaillé sur Wittig. Dans le deuxième, la sociologue Natacha Chetcuti nous présente brillamment l’essentiel de la pensée wittigienne
L’article “Monique Wittig. Icône lesbienne et théoricienne révolutionnaire” dans la revue La Déferlante (n°2, 2021), d’Ilana Eloit, qui a écrit une thèse sur le sujet, chercheuse et co-organisatrice du colloque à venir “Monique Wittig : 20 ans après” : très documenté (passion archives) mais néanmoins très accessible, et qui consiste en partie en une réécriture lesbienne de l’histoire du MLF, histoire confisquée jusqu’alors par les militantes hétérosexuelles
Une série d’ateliers qu’on a intitulés aux Jaseuses, dans le cadre de l’année Wittig, “Questions bêtes-pas bêtes”, pour aborder toutes ces questions qu’on n’ose pas forcément poser. Le premier, “Pourquoi Wittig ?”, aura lieu le mardi 31 janvier à 14h30 sur Zoom (lien prochainement disponible sur le site et les réseaux sociaux des Jaseuses). Il s’adresse à toutes les personnes intéréssées par le sujet, et pas uniquement/spécifiquement aux chercheureuses.
Qui dit nouvelle année dit aussi nouvelle rentrée littéraire : j’ai commencé mes lectures, j’en parlerai bientôt. Pour avoir un aperçu de ce qui va sortir, c’est par ici, sur mon carnet.
Mic drop
“J'ai su que j'avais été privée d'elle avant de la rencontrer” (Violette Leduc, “Thérèse et Isabelle”)
Des interviews d'acteurices du monde du livre (des auteurices mais pas seulement)
Pour la première interview de cette newsletter, j’ai voulu poser quelques questions à Lauren Delphe, autrice d’un premier roman, Faite de cyprine et de punaises, dont j’ai fait un lobby relativement intensif ces derniers mois. Merci à elle d’avoir pris le temps de répondre !
TW : violences sexuelles, validisme (dans la deuxième question)
Tu as publié ton premier roman, Faite de cyprine et de punaises fin septembre aux Editions iXe (bravo !!), dans lequel on suit à Montréal la narratrice (dont on ne connaîtra jamais le prénom) à la vie, disons, un peu chaotique, qu'il s'agisse de sa vie professionnelle, amoureuse, ou de sa santé mentale. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce roman ?
Je crois que j’avais besoin d’un projet to call my own, je travaillais toute la journée à servir une clientèle qui m’horripilait, je rentrais le soir crevée, mangeais un bol de pâtes au ketchup puis recommençais. J’ai commencé à écrire sur mon téléphone au travail pour perdre mon temps plus rapidement, puis ai progressivement débordé sur mon temps personnel - ma vie étant un peu chaotique, c’était une belle échappatoire qui me permettait de m’amuser sans me créer de nouveaux problèmes.
Quant au roman lui-même, il m’était essentiel de l’écrire pour pouvoir continuer à fonctionner en société, ou tout du moins à m’assurer le bare minimum, un toit au-dessus de ma tête et de quoi remplir mon assiette.
J’étais contrainte dans ma vie professionnelle de me montrer souriante et aimable même dans des conditions de travail déplorables, à servir une société capitaliste et patriarcale qui jouait pourtant contre moi ; il fallait bien cracher mon venin quelque part pour pouvoir continuer à nourrir mes convictions tout en payant mon loyer.
De même dans ma vie amoureuse, j’ai écrit toutes les ruptures que je rêvais de prononcer ou de surmonter - et l’écriture a souvent aidé à passer le cap. En outre, si l’on connaît toustes l’importance d’avoir une chambre à soi, elle n’est pas forcément donnée à toustes, plus particulièrement dans des relations abusives. Un projet à soi aide tout autant à regagner du pouvoir sur son schéma narratif, et reste bien plus abordable.
Finalement, sur la question de santé mentale, il me semble que c’est un thème qui transparaît sans qu’il soit explicitement traité dans le roman ; la désinvolture donnée aux différents sujets, mêmes les plus durs, relève davantage de l’inconscience et de coping mechanisms que d’une réflexion très mûrie de la part de la narratrice. La beauté de l’écriture réside notamment dans sa brutale honnêteté, plus je tentais la légèreté et plus j’y lisais une façon de compenser. Jusqu’à ce roman, je me nourrissais de ma colère et de ma frivolité pour me berner et me convaincre d’avancer ; avec l’écriture, j’ai compris l’importance de s’avouer désemparée devant des situations que l’on ne peut tout simplement pas surmonter. Ça n’enlève rien à ma colère, bien au contraire, faire face à ma réalité handie et gouine – souvent joyeuse mais aussi douloureuse-, me permet d’être non seulement plus douce avec moi-même mais également plus vindicative à l’égard des personnes qui ne veulent pas faire face à la situation humaine parfois épouvantable dans laquelle nous nous trouvons.
Il est souvent question, dans le roman, des violences, physiques comme psychologiques, subies par la narratrice. Elle est, de façon régulière, violée par son ex, Marcela. Et elle est victime de validisme au quotidien, dans la mesure où personne dans la société - à l'exception du personnage d'Olivia - ne prend en compte son handicap (les portes lourdes à ouvrir d'un seul bras, les sacs à porter, etc.). Les passages sur ces sujets ne sont généralement pas très longs, mais ils sont présents tout au long du roman : est-ce que leur écriture a été difficile ? Quels ont été, pour toi, les enjeux d'écriture de ces scènes ?
Concernant le validisme, la réponse sera brève, non, ces passages étaient non seulement faciles à écrire mais aussi très délibérés. J’écris pour exprimer tout ce qui m’est interdit de prononcer, et puisque nous n’avons jamais le droit de nous plaindre du validisme, j’avais beaucoup de choses à écrire. La narratrice suit un cheminement militant, qui commence sous l’angle du modèle médical du handicap : la première mention du handicap concerne un pot que la protagoniste n’arrive pas à ouvrir « à cause de sa main paralysée » - ce qui explique son admiration face aux plaisirs culinaires les plus simples qui devraient pourtant être accessibles à toustes. Cette première approche est suivie par le modèle social du handicap (elle galère dans le métro car il n’y a pas d’ascenseurs, et non plus à cause de sa jambe) pour terminer avec un modèle politique, où il est question de fierté, d’identité et de communauté, plutôt que de contraintes médicales ou sociales - modèle qui reste certes pour l’instant assez utopique, mais à quoi sert l’écriture si ce n’est à imaginer de meilleurs futurs gouins et handis.
L’enjeu le plus important, comme sur toutes les questions de violence par ailleurs, a été de me donner la permission de me plaindre. J’ai grandi avec l’impératif d’être forte - une hyène -, mais également de reconnaître les difficultés posées par le validisme tout en montrant qu’elles ne m’atteignaient pas, moi, personnellement, par un quelconque miracle sociétal. Une spécificité du validisme, où toustes les valides reconnaissent les discriminations – l’habituel « si j’étais toi, je ne pourrais pas le faire » -, mais n’attendent pas de moi que je leur réponde « je suis moi, et je ne peux pas le faire », qui semble pourtant couler de source. Je ne sais pas si j’ai réussi la tâche que je me suis donnée : je ne voulais certainement pas tomber dans le misérabilisme, tout en étant claire quant aux conséquences d’un système validiste où l’on ignore la dignité des personnes handies. J’aimerais que dans mon roman transparaisse cette indignité, tant dans la fierté et la rancune de la narratrice que dans son désarroi.
(TW)
Quant aux viols, si les passages n’ont pas été difficiles à écrire - les pages blanches ne jugent jamais -, les nommer correctement a été une tout autre affaire. J’ai commencé par de beaux euphémismes (« quelques mauvaises expériences », « des dérapages », etc.) avant de réaliser après moult relectures que le mot s’imposait, car il s’agit de ma protagoniste et non de moi - la distance qu’impose l’écriture offre de nouvelles perspectives et ainsi la possibilité de se rendre justice en légitimant les expériences que l’on n’arrive pas à s’admettre à soi-même. Comme quoi, l’écriture sait se montrer tout aussi brutale que clémente.
L’enjeu ici a été essentiellement lesbien : je savais que j’écrivais un roman particulièrement sexuel, je voulais en montrer les joies et les nombreuses jouissances, les viols n’avaient donc rien à faire ici. Il se trouve que les violences n’épargnent personne et certainement pas les lesbiennes, et que les questions de domination, même patriarcale, sont également présentes au sein même des couples queer – qui l’eût cru.
Pour autant, j’espère avoir réussi parallèlement à décrire la tendresse de l’amour lesbien - être lesbienne est une fête, après tout -, et l’immense plaisir offert par le sexe gouin entre personnes consentantes et informées.
Le roman est également parsemé d'humour lesbien, qu'il s'agisse de références plus ou moins ironiques à des séries (Orange Is The New Black) ou de la description des différents types de lesbiennes qu'on trouve à Montréal (et ailleurs), autant d'éléments qui font rire le lectorat lesbien ou plus largement queer. Bref, c'est un roman très lesbien. Les auteurices de littérature lesbienne disent souvent qu'iels ont écrit le roman qu'iels auraient voulu lire. Est-ce que tu aurais aimé avoir ce genre de représentations, plus jeune, pour t'aider à te construire en tant que lesbienne ?
Non, je ne suis pas certaine que lire les histoires d’une protagoniste aussi désemparée m’aurait aidée à me construire en tant que lesbienne – elle est loin d’être un modèle à suivre, et les références parsemées tout au long du livre seraient beaucoup plus utiles à ces jeunes en quête de représentation.
J’ai cependant écrit le roman que j’aurais voulu lire, à mon âge, en étant déjà soutenue par mes lectures et mes expériences passées - en étant consciente que la vie gouine n’est pas facile à mener mais qu’elle regorge de beautés cachées, et qu’elle offre bien plus et bien mieux que tout ce que les queerophobes pourraient jamais imaginer.
Il n’a pas comme objectif d’aider quiconque à se reconstruire – je serais bien mal placée pour donner des conseils à qui que ce soit, réfugiez-vous dans les récits de personnes plus braves que moi, Audre Lorde, Monique Wittig, Alison Kafer, Angela Davis - mais plutôt d’abandonner cette armure d’invulnérabilité qui était de toute façon déjà bien fissurée, et bien trop lourde à porter.
Quelque chose à ajouter ?
Merci merci mille fois à toi, pour tout ton travail et tous tes projets, j’ai hâte de découvrir mille autres refuges dans cette NL ❤️